Député des Hauts-de-Seine depuis juin 2017. Il a été Professeur associé à l’IEP de Paris de 2002 et 2015 et député européen de 1989 à 2007. Ancien Conseiller maître à la Cour des comptes et Conseiller référendaire à la Cour des comptes. Il est ancien élève de l’École Nationale d’Administration (Promotion Michel de l’Hospital 1977-79), agrégé de lettres modernes et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.
Ayman Cherkaoui
Directeur Exécutif du Réseau Global Compact Maroc. Il est également Coordinateur de Projet au sein de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement ainsi que Conseiller Principal du Programme des Changements Climatiques du Centre de Droit International du Développement Durable. Il a notamment été auparavant Conseiller Spécial auprès de la Présidence de la COP22, a aussi travaillé pour Valyans Consulting et l’Association Internationale de Transport Aérien. Il a des connaissances approfondies dans les domaines de l’ingénierie, du droit, de la finance, des changements climatiques et du développement durable. Il a été honoré à titre de Leader Africain par la Fondation Obama, et de Leader Emergent par l’OCP Policy Center.
Rahma Bourqia
Directrice de l’Autorité nationale d’évaluation du Conseil supérieur de la formation et de la recherche au Maroc (nommée en 2014), ancienne présidente de l’Université Hassan II Mohammedia Casablanca, ancienne doyenne et professeure de sociologie à l’Université Mohamed V Agdal Rabat. Elle est également membre de l’Académie royale marocaine. Elle a été conférencière et conférencière invitée lors d’activités de recherche dans des universités aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Elle a reçu le titre honorifique honoris causa de l’Université d’Indiana State aux États-Unis en 2006, de l’Université de Liège en Belgique et de l’Université Paris Ouest Nanterre à Paris (France) en 2010.
Sandiso Sibisi
Entrepreneure à la tête du programme Open Innovation for Africa chez Accenture, elle permet à des start-ups d’améliorer leur accès au marché pour accélérer leur croissance. Elle a fondé le programme Born to Succeed, qui vise à réduire le taux de chômage élevé des jeunes en Afrique du Sud grâce à l’éducation, au mentorat et à la création de partenariats avec le secteur privé. Elle a été vice-présidente de l’Advancement of Black Accountants South Africa Bursary Fund, qui vise à lutter contre les difficultés en matière de financement rencontrées par des étudiants issus de milieux défavorisés pour accéder aux établissements d’enseignement supérieur. En 2016, elle a été sélectionnée parmi 4 000 candidats d’Afrique du Sud pour la bourse Mandela Washington aux États-Unis. Elle a également représenté l’Afrique du Sud au Sommet de la Banque mondiale à Washington, où elle a présenté sa plateforme EdTech intitulée «Khwela». Elle a, entre autres, été nommée ambassadrice des Objectifs de développement durable par l’Ambassadrice Dessima Williams au Canada. Elle est aussi ambassadrice de Play Your Part avec Brand South Africa et figure parmi les 100 plus grands leaders en devenir selon le classement Mzansi en 2017.
Touria Benlafqih
Fondatrice et PDG, EMPEOPLE. Elle se concentre sur le rôle des jeunes dans la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale en Afrique. Elle a été impliquée dans l’entrepreneuriat social et l’autonomisation des jeunes et des femmes au cours des 12 dernières années. Elle travaille avec des organisations à but non lucratif en tant que bénévole, professionnelle et consultante, avec plus de 6 années consacrées à l’employabilité des jeunes pour résoudre l’un des plus grands problèmes de l’Afrique: le chômage. En 2015, elle a créé le SIDE (Social Impact and Development Employment), une entreprise sociale axée sur la question du chômage des jeunes. En 2016, elle a fondé EMPEOPLE (Empower People). Elle a travaillé sur l’autonomisation des femmes, l’éducation, l’engagement des jeunes dans les affaires publiques, le développement rural et la préservation des oasis, pour enfin se concentrer sur l’autonomisation des jeunes. Ancien directeur de programme d’Enactus Maroc. Auparavant, elle était l’assistante administrative et financière du projet mené par le PNUD sur l’adaptation au changement climatique dans les oasis au Maroc.
Fareed Mohamedi
Directeur général de SIA-Energy International, une société de conseil spécialisée dans le secteur du pétrole et du gaz chinois basée à Pékin. Avant de rejoindre SIA-Energy, il était économiste en chef de Rapidan Energy. Il a également été conseiller principal au service de planification générale chez Saudi Aramco. Il a été vice-président de l’analyse sectorielle au service de la stratégie d’entreprise et du développement commercial chez Statoil. Pendant plus de 20 ans, Fareed a été l’un des associés de PCF Energy, où il a forgé son expérience en matière d’analyse du risque-pays et du marché pétrolier. Il a aussi travaillé en tant que macro-économiste à la Banque mondiale et au ministère de de l’Économie et des Finances du Royaume de Bahreïn, entre autres. Il a obtenu un master en études arabes du Centre d’études arabes contemporaines de la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown, Washington, et une licence en économie de l’Université de Western Michigan.
Tayeb Amegroud
Senior Fellow, OCP Policy Center, spécialisé dans l’énergie, les énergies renouvelables, le développement de projets, l’évaluation et le financement et la structuration. Fondateur de GPower Consultants et expert en planification énergétique et développement de projets, évaluation, financement et structuration. Il a 18 ans d’expérience combinée dans des projets énergétiques et des services bancaires d’investissement. Dans son dernier poste, il était directeur chargé du développement des projets d’énergie renouvelable, de la planification et de la stratégie à l’Office national de l’électricité (ONE) et membre du comité exécutif. Auparavant, il était directeur exécutif chez Swiss Re à New York et à Londres et a occupé le même poste chez Lehman Brothers et divers autres groupes financiers internationaux.
Shiv Vikram Khemka
Vice-président de SUN Group, groupe mondial menant des activités d’exploitation et d’investissement diversifiées dans les domaines suivants : capital-investissement, énergies renouvelables, pétrole et gaz, technologie de pointe, extraction aurifère et immobilier. Il est Président exécutif de la Global Education & Leadership Foundation (tGELF). Il siège au sein de nombreux comités et conseils d’administration. Il est membre de la délégation du BRICS Business Council et est à la tête de la représentation indienne auprès de l’Organisation de coopération de Shanghai. Il siège au Conseil national et au Conseil international de la Confédération de l’industrie indienne (CII) et préside la Commission pour l’Asie centrale de la CII. Il est aussi coprésident du Conseil d’aérospatiale et de défense à la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie indiennes. Il a étudié au Eton College, a obtenu un BA d’économie de Brown et un MBA avec mention de la Wharton School of Business et du Lauder Institute de l’Université de Pennsylvanie.
Jacques Michel
Directeur Général de JMS Advisory, administrateur de sociétés et conseil financier. Jusqu’à mi-2022, il a occupé différents postes de direction dans le réseau international de BNP Paribas. Son dernier poste fut celui de CEO/Chairman de BNP Paribas Moyen-Orient et Afrique pour la Banque de Financement et d’Investissement, de 2015 à 2022. Il exerça au préalable, de 2009 à 2015 les fonctions de CEO de BNP Paribas en Inde. Avant de rejoindre BNP Paribas, il a été Directeur Régional des Risques pour l’Asie-Pacifique de 1999 à 2009, du Crédit Lyonnais puis Calyon puis Fortis Bank. De 1995 à 1999, il a été Directeur Général du Crédit Lyonnais en Thaïlande, après avoir été Directeur Régional de la BFCE pour l’Asie du Sud-Est, basé à Singapour de 1990 à 1995. Il est Conseiller du Commerce Extérieur de la France. Il a été Président du Comité de Hong-Kong, il est aujourd’hui Président du Comité de Bahreïn. Il est Président d’Honneur de la Chambre de Commerce Franco-Indienne. Il est aussi au Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Franco-Bahreïnie. Il est diplômé de l’ESSEC.
Suzanne Hayden
Avocate assermentée, Mme Hayden a passé trente ans dans le service public et l’application de la loi en tant que conseillère principale auprès de membres du gouvernement américain – Justice, État, Trésor, Renseignements et Défense – et d’organisations internationales, telles que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Académie internationale de lutte contre la corruption (AIAC). Ancienne procureure principale du ministère de la Justice des États-Unis, elle a également été la première coordonnatrice de la sécurité nationale du département de la Justice des États-Unis et la représentante du ministère de la Justice auprès du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), l’organisme mondial de normalisation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En tant que procureur au TPIY, Mme Hayden a créé la première unité d’enquête financière de l’ONU et dirigé l’enquête financière sur Slobodan Milosevic. Elle fournit actuellement une assistance technique et des conseils à des organisations des secteurs public et privé dans des domaines tels que le renforcement de l’intégrité, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, siège au conseil d’experts pour PMI IMPACT et travaille avec une organisation sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages.
Europe’s Critical Election
Ahead of the European Parliament election in May 2019, nationalist parties across Europe are unifying behind a message that is clear, forceful, and, for many, compelling. If Europe’s defenders are to win, they will need to offer a vision that is similarly powerful – and not hide behind French President Emmanuel Macron.
The Case Against Climate Despair
The growing severity and frequency of extreme-weather events suggests that climate scientists’ nightmare scenarios must be taken seriously. Fortunately, rapid advances are being made in clean-energy technology and carbon-neutral forms of living.
STOCKHOLM – Heat waves and extreme-weather events across the Northern Hemisphere this summer have brought climate change back to the forefront of public debate. Early analyses strongly suggest that natural disasters such as Hurricane Florence – which barreled into the US East Coast this month – have been exacerbated by rising global temperatures. Though US President Donald Trump has reneged on the 2015 Paris climate agreement, the rest of the world is becoming increasingly convinced of the need to limit greenhouse-gas (GHG) emissions.
Last month, a group of climate scientists published a report in the US Proceedings of the National Academy of Sciences warning that the planet could be on a path to becoming a “hothouse” that may not be habitable for humans. The Earth has already registered the highest temperatures since the last Ice Age. But, as the report notes, what we are experiencing today will be nothing compared to what is in store if average global temperatures surpass 2° Celsius above pre-industrial levels.
At that point, the authors write, “[global] warming could activate important tipping elements, raising the temperature further to activate other tipping elements in a domino-like cascade that could take the Earth System to even higher temperatures.” The scientific debate about climactic tipping points and nightmare scenarios is ongoing. But no one can say for certain that the risks outlined in the “Hothouse Earth” report are not real.
But there is another risk: that warnings such as these will lead to despair. Numerous reports have already concluded that it will be exceedingly difficult to meet the targets outlined in the Paris agreement. But to conclude that the situation is hopeless is not just dangerous; it is also factually incorrect. After all, political and technological developments that are currently underway offer grounds for genuine hope.
At the Global Climate Action Summit in San Francisco, California, this month, there was plenty of talk about the numerous alarming reports that have come out in recent months and years. But the real focus was on the Exponential Climate Action Roadmap, a major new study showing that progress in the use of non-fossil-fuel technologies is advancing not just linearly, but exponentially.
You may not realize it, but solar- and wind-power usage is doubling every four years. If that continues, at least half of global electricity production could come just from these two forms of renewable energy by 2030. And there is no good reason to think that progress couldn’t accelerate further. Just in the past few years, there have been rapid advances in solar-energy technologies and energy storage.
The Global Commission on the Economy and Climate estimates that $90 trillion will be invested in new infrastructure around the world over the course of the next 15 years. Owing to the new technologies that are now emerging – not just in energy but in the digital domain as well – humanity could have an historic opportunity to leapfrog into far more sustainable, carbon-neutral patterns of habitation.
Moreover, in addition to the far-reaching advances in technology, there is also growing private- and public-sector awareness of the importance of factoring sustainability into all decisions. New approaches to energy, industry, architecture, city planning, transportation, agriculture, and forestry have the potential to halve GHG emissions by 2030. But that will happen only if a broad coalition of decision-makers decides to deploy them.
Fortunately, governments and major corporations have begun to show leadership on these issues. As a result, GHG emissions have already peaked in 49 countries that account for 40% of global emissions; and ten countries have even committed to being carbon-neutral by 2050. California and Sweden say that they will produce zero net emissions by 2045.
The Exponential Climate Action Roadmap shows that we do still have a say over our climate future. The dangers that await us cannot be denied. If GHG emissions and rising temperatures continue on their current trajectories, we could well reach the point at which future generations will have to endure “Hothouse Earth,” assuming that they can survive at all.
But just as recent scientific work has underscored the dangers of climate change, so, too, has it shown the way forward. There is hope in the rapid diffusion of new technologies, and in the growing awareness of the problem within industry, government, and civil society. If we can ensure exponential technological progress and marshal the necessary political will, we can tackle the climate crisis. A “Stable Earth” is still within our reach.
Renaud Girard : «Pourquoi Donald Trump veut aller jusqu’au bout sur la Chine»
25 septembre 2018
Trump veut aller jusqu’au bout sur la Chine
Le porte-parole du gouvernement chinois vient d’accuser les Etats-Unis d’avoir commencé « la plus grande guerre commerciale de l’Histoire économique ». Le lundi 24 septembre 2018, sont entrés en vigueur les nouveaux droits de douane imposés par le président Trump aux produits chinois. 200 milliards de dollars d’exportations chinoises vers les Etats-Unis sont touchées (sur un total de plus de 500 milliards par an). La surtaxe décidée par la Maison Blanche est de 10%, mais elle grimpera à 25% en 2019 si les deux gouvernements ne parviennent toujours pas à s’entendre. Les Chinois ont épuisé leurs moyens, dans la mesure où leurs importations d’Amérique ne dépassent pas les 130 milliards annuellement.
L’offensive tarifaire du président Trump contre la Chine est une politique qui a reçu un soutien substantiel des parlementaires américains (démocrates comme républicains) et des alliés européens des Etats-Unis. La chambre de commerce européenne en Chine a expliqué que la cause première de cette guerre commerciale sino-américaine est l’ouverture incomplète des marchés chinois aux biens et services en provenance de l’étranger.
Les autorités chinoises ne peuvent se plaindre de ne pas avoir été prévenues. Depuis qu’il a été élu, Donald Trump leur a demandé de modifier leurs pratiques commerciales, notamment lors du sommet de Mar-a-Lago (Floride) d’avril 2017. Au forum économique de Davos, en janvier 2018, Trump a déclaré : « Nous sommes en faveur du libre-échange, mais il doit être juste, et il doit être réciproque ! » Or les Américains estiment que la Chine, depuis trente ans, n’a jamais fait preuve de réciprocité dans son commerce avec les Etats-Unis, et qu’elle s’est montrée de surcroît très injuste.
Washington ne reproche pas seulement à Pékin l’énormité du déséquilibre commercial entre les deux nations. Les Américains accusent les Chinois de violer les règles de l’OMC (dont la Chine est membre depuis 2001) en ayant systématiquement recours au dumping et aux aides d’Etat camouflées. Trump est le premier dirigeant occidental à avoir dénoncé les stratégies chinoises de pillage technologique et d’intimidation des investisseurs occidentaux en Chine. Tel industriel souhaitant s’installer en Chine est prié de constituer une joint-venture avec un industriel local. Au début, les relations avec l’associé chinois sont merveilleuses, les usines démarrent, la distribution suit, les clients apprécient, l’investisseur occidental gagne de l’argent. Mais dans une deuxième phase, l’associé chinois se saisit d’un prétexte pour quitter soudainement la joint-venture. Les Occidentaux le retrouveront bientôt dans une autre usine, fabriquant des produits similaires, grâce à toute la technologie qu’il a auparavant volée. S’ils osent se plaindre, le Ministère de l’Intérieur les menace de leur retirer sur le champ leurs titres de séjour.
Trump a décrété que les Chinois ne voleraient plus jamais la technologie américaine. La Chine va-t-elle se soumettre aux demandes américaines ? Va-t-elle réagir de manière rationnelle ou émotionnelle ? Rationnellement, les Chinois seraient bien avisés de faire des concessions car ils ont davantage besoin de l’Amérique (en termes de formations universitaires, de technologie à importer et de marchés à l’export) que l’Amérique a besoin d’eux. Les 2000 milliards de bons du trésor américain que détient la Chine ne peuvent constituer pour elle un moyen de pression. Les vendre massivement reviendrait pour elle à se tirer une balle dans le pied, par dépréciation de ses actifs. Et les Américains trouveraient toujours preneurs ailleurs pour leurs obligations libellées en dollars.
Mais une dernière mesure américaine, d’une toute autre nature, pourrait très bien déclencher une réponse émotionnelle, c’est-à-dire nationaliste, de la part des Chinois. Le 20 septembre 2018, en vertu des lois américaines d’embargo votées après l’annexion de la Russie et après l’affaire Skripal, l’EDD, qui est l’organisme chinois chargé d’améliorer la technologie des armements de l’APL (Armée populaire de libération) et son chef, Li Shangfu, ont été sanctionnés pour avoir acheté à la firme d’Etat russe Rosoboronexport une dizaine de chasseurs bombardiers Sukhoi 35 ainsi que des missiles sol-air S-400. Leurs comptes sont gelés aux Etats-Unis et interdiction est faite à toute personne morale ou physique américaine d’être désormais en affaires avec cette personne et cette entité chinoises. L’Amérique a encore étendu l’extraterritorialité de son droit, car la transaction sino-russe n’était pas libellée en dollars…
Les Chinois vont-ils se sentir victimes de traités inégaux comme au XIXème siècle et se rebeller ouvertement contre l’Amérique ? C’est possible, car ils ont exigé d’elle publiquement le retrait de ces sanctions. Qui cédera le premier ? La réponse n’est pas pour demain. Ce n’est que le début d’un très long bras de fer…
Renaud GIRARD
Is the World Becoming a Jungle Again? Should Americans Care?
By Steven Erlanger
Sept. 22, 2018
BRUSSELS — President Trump seems determined to upend 70 years of established American foreign policy, especially toward Europe, which he regards as less ally than competitor.
The Trump turnabout has set off a fervent search on both sides of the Atlantic for answers to hard questions about the global role of the United States, and what a frazzled Europe can and should do for itself, given a less reliable American partner.
The German foreign minister, Heiko Maas, speaking before a conference of all Germany’s ambassadors last month, argued for a stronger European foreign and defense policy in the face of a suddenly uncertain future.
“The rules-based international order” is eroding in a world where “nothing can be taken for granted any more in foreign policy,” he said.
As a measure of just how cross-fertilized the thinking has become, Mr. Maas, a Socialist, cited the conservative American thinker Robert Kagan of the Brookings Institution and his forthcoming book, “The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World.”
His is one of several new books to take on the issues. In Mr. Kagan’s view, the United States’ retreat as the enforcer of the order it created after World War II is returning the world to its natural state — a dark jungle of competing interests, clashing nationalism, tribalism and self-interest.
“The liberal world order established by the United States a little over seven decades ago is collapsing,” Mr. Kagan writes, a function of American exhaustion with global burdens that began before Mr. Trump was elected and was one of the reasons for his victory.
But as a tired America pulls back from tending what Mr. Kagan calls “the garden” of the liberal order — an exceptional 70 years of relative peace and free trade, “a historical anomaly” made possible by U.S. leadership — the dangers are considerable, especially for Europe, he argues.
Already strained by populism and identity politics, Europe is in danger of returning to the strife that produced totalitarianism in the 1930s, he warns.
“The crucial issue is not the Middle East or even Russia, and it may not even be China,” Mr. Kagan said. “The big game is what it’s been for over a century. If we lose Europe, if we send Europe back to its normal condition, it’s over.”
But his prescription — that the United States suck it up and understand that it must remain the indispensable guarantor — is hardly universally shared at a moment when many appear sympathetic to Mr. Trump’s complaint that America’s allies do not do enough for collective defense.
Julianne Smith, a former adviser to Vice President Biden and now a visiting fellow at the Robert Bosch Academy in Berlin, recently traveled the United States talking about foreign policy.
“If in Washington the bipartisan view is do more, outside people ask if we’ve been too ambitious,” she said.
“We’re in a situation where the public doesn’t see the evidence to support Kagan’s arguments,” she said. “Congress is not there, the media is not there, the public is not there, and business is there only sometimes.”
Stephen M. Walt of Harvard University argues in his own forthcoming book, “The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy,” that the United States should do less in the world, and a lot more selectively.
Part of the “realist” school, Mr. Walt says that since the end of the Cold War, the United States has engaged in a series of expensive, largely unnecessary and ultimately failed efforts to remake nations in its own unusual image.
The metaphor of a garden “implies our role is benign and benevolent, when actually we’ve been blowing up a lot of stuff,” he said.
“If we go running around the world on idealistic crusades, and some go badly, as they will, then public support for an activist foreign policy will decline.”
Tomas Valasek, who runs Carnegie Europe, a research institution, considers that view too pessimistic.
“I agree that it’s not inevitable that the U.S. will always play the same role, but I disagree that mayhem necessarily follows,” he said. “The U.S. has changed Europe’s security culture,” making Europeans more conscious of the need to defend themselves.
“It’s not the 1930s,” Mr. Valasek said. “There are ugly forces at work in Europe but not of the same kind, and I don’t share Kagan’s assumption that European elites will fail to respond.”
“We must make clear to the American people that it’s in their enlightened self-interest to stay engaged, and that others are stepping up, paying and doing their share,” he added.
The shift in American attitudes “toward a post-imperial role” began before Mr. Trump, with the failure of the Iraq war, noted Nathalie Tocci, director of Italy’s Institute of International Affairs and an adviser to E.U. foreign-policy chief Federica Mogherini.
But for her, “the silver lining in Europe is that even the current dodgy leaders realize we’re all very small.”
“There is a growing realization that a stronger Europe and European Union are a necessity, whatever the faults,” she said.
Daniel W. Drezner, who teaches international politics at Tufts University’s Fletcher School, argues that “Americans are sick of wars in Afghanistan and Iraq,” but that both Mr. Kagan and Mr. Walt are wrong about American public opinion.
“Ask them about trade, immigration and alliances, and it turns out that Trump has made liberal internationalism great again,” he said, with Americans favoring international trade and alliances with European and Asian democracies.
Indeed, surveys show that American attitudes on trade and mutual alliances are the most positive in 40 years, said Ivo H. Daalder, president of the Chicago Council on Global Affairs.
“Americans are not sick of foreign engagement but of stupid, endless foreign wars,” he said.
Mr. Daalder and James M. Lindsay also have a forthcoming book, “The Empty Throne: America’s Abdication of Global Leadership,” describing the impact of what they consider the greatest shift in American foreign policy since the retreat from Europe after World War I.
Like Mr. Kagan, they see dire consequences. But they also argue that even if Mr. Trump won’t tend the liberal world order, America’s nine most democratic allies can do more to preserve it — in both global trade and security.
Mr. Lindsay and Mr. Daalder call for a “G-9” of Britain, France, Germany, Italy, Australia, South Korea, Japan, Canada and the European Union to act more boldly in their own interest, as they are already doing on trade.
Mr. Kagan wants to influence those choices. Despite mistakes in Iraq, Afghanistan and Libya, retreat in the name of “reality” is naïve and ahistoric, he argues.
“After decades of living within the protective bubble of the liberal world order, we have forgotten what the world ‘as it is’ looks like,” he said. “To believe that the quarter-century after the Cold War has been a disaster is to forget what disaster means in world affairs.”
Making the Most of Emerging Economies
–
Investors may find it tempting to pursue a broad risk-off approach to the entire emerging world, especially in the context of rising global trade tensions. But it would be a mistake to ignore the very favorable conditions that exist in some emerging economies.
PARIS – Once again, the world’s emerging economies are facing a bout of uncertainty. Argentina, South Africa, and Turkey are among those generating the most concern, owing to a combination of questionable monetary policies and currency depreciation vis-à-vis the US dollar that threatens to undermine these countries’ ability to service their debts. But not all emerging economies are created equal.
To be sure, as in the past, there is a distinct risk of contagion. The emerging economies that are most vulnerable each must address its own challenges to avoid falling victim. And the approaches countries take to the challenges they face will have knock-on effects of their own.
Given this, investors may find it tempting to pursue a broad risk-off approach to the entire emerging world, especially in the context of rising global trade tensions. But it would be a mistake to ignore the very favorable conditions that exist in some emerging economies. For example, many have made significant progress in managing their debt levels, raising productivity, improving infrastructure, and implementing needed reforms.
All of this has contributed to strengthening these economies’ resilience to external shocks. Indeed, despite enduring uncertainties over the degree to which they have absorbed the lessons of the past, not to mention inconsistencies across countries, many emerging economies have developed much sounder fundamentals over an extended period.
The disparity between perceived and actual risk and the tendency to paint all emerging economies with the same brush is a longstanding problem. But investors should eschew a wholesale retreat from emerging economies in response to high-profile problems in a few. Instead, they should adopt a more nuanced approach, one focused on improving the risk-return profile by investing in selected regions and markets, while working with the right institutions.
In particular, now is not the time to ignore Latin America and the Caribbean, which have a wide range of investment needs – touched upon during the recent G20 meetings in Argentina – and also offer a broad range of growth opportunities. Countries in this region have pursued substantial reforms that have boosted economic growth and laid the foundations for strong financial returns in the longer term.
More broadly, stakeholders should strengthen their commitment to using the “billions to trillions” approach to resolving the world’s most vexing problems. That approach uses a combination of measures related to finance, skills, capacity, and risk allocation to leverage relatively scarce public-sector capital to mobilize more robust private-sector resources.
The multilateral development banks have a critical role to play here, and many have made great strides in responding to market needs. Moreover, the world has agreed, under the auspices of the United Nations, on complementary road maps for addressing global challenges: the Paris Climate Agreement and the Sustainable Development Goals. By establishing the right mechanisms to take advantage of related investment opportunities, we can use billions of public dollars to make trillions of dollars’ worth of progress.
Many of us in the investment community are working to boost the effectiveness of our work by ensuring that the right financial and risk-management instruments are in place to connect the public and private sectors. Already, mechanisms are in place to facilitate capital flows into emerging economies, particularly those in Latin America and the Caribbean, where opportunities for attractive risk-adjusted returns are now available.
In this context, even a very modest allocation by large institutional investors will have a major impact on the pursuit of sustainable outcomes, while also providing attractive, competitive financial returns. This dynamic – a fundamental component of the billions-to-trillions approach – can become embedded, creating the basis for a broader system in which there is no trade-off between making money and doing good.
The current turmoil in some emerging economies must not be allowed to derail past progress. On the contrary, it should spur stakeholders to redouble their collective efforts to establish a broadly beneficial system. This means, first and foremost, taking a nuanced approach to risk assessment that recognizes the attractive long-term growth opportunities that many emerging-market economies offer.
Juliette M. Tuakli
Ambassadrice diplomatique de Mercy Ships pour l’Afrique depuis 2022. Elle supervise les partenariats avec les gouvernements et les entités et communautés diplomatiques pour soutenir la mission de Mercy Ships consistant à fournir des soins médicaux et chirurgicaux gratuits à celles et ceux dans le besoin à travers le continent africain. En mai 2022, elle a tenu un rôle clé dans l’inauguration du Global Mercy™, le navire-hôpital porte-étendard de l’association, à Dakar (Sénégal). Pédiatre et spécialiste en santé reproductive de renom, Dr. Tuakli a été la première femme africaine à occuper le poste de professeure de pédiatrie clinique à la Harvard Medical School où elle a notamment contribué à la création du département de médecine communautaire de l’hôpital pour enfants de Boston. Elle est la fondatrice et a été directrice médicale de CHILD Accra au Ghana. Ses actions en faveur de l’éducation à la santé des enfants en Afrique et aux États-Unis ont été acclamées dans le monde entier. En tant que première femme présidente du club Rotary au Ghana, elle a fait avancer la législation sur la protection infantile pour les enfants africains, un travail qui lui a valu la reconnaissance de l’Union africaine. Elle est également à l’initiative de la mise en place d’une rotation chirurgicale, financée par le Rotary, devenue depuis une formation reconnue à la chirurgie sécuritaire en Afrique. Soutenue par l’OMS, la formation se déroule à bord de la flotte de Mercy Ships. Dr. Tuakli a siégé à de nombreux conseils d’administration internationaux, à commencer par ceux de Mercy Ships, de Zenith Bank, du Global Virus Network et de CarePoint. En 2022, elle a quitté le conseil international de United Way Worldwide où elle avait été la première femme et la première personne non-blanche. Reconnue en tant que dirigeante engagée pour la santé mondiale, elle a reçu de nombreux prix, notamment le prix Global Citizen Award de l’ONU et d’autres récompenses pour l’ensemble de sa carrière.
Salim Jreissati
Ministre de la Justice, Liban. Avocat à la cour, inscrit au barreau de Beyrouth, président de l’Association nationale pour la protection de la constitution et de la loi depuis 2016. Ancien membre du Conseil constitutionnel et ancien ministre du Travail. Il est détenteur de l’Ordre du mérite national, détenteur de l’Ordre patriarcal de Jérusalem et détenteur de l’Ordre du cèdre national au rang de commandeur.
Jacques Beltran: «L’Europe trois fois malade»
21 septembre 2018
En médecine européenne, l’erreur de diagnostic est fréquente. Elle confond les maux et les symptômes. Tout le monde ou presque s’accordera à dire que l’Union européenne est désunie face à la crise migratoire, qu’elle peine, malgré de récentes avancées, à se doter des moyens d’une défense commune, qu’elle prend du retard face aux Etats-Unis et à la Chine dans plusieurs domaines économiques clés comme le développement des plateformes numériques, qu’elle est largement démunie face aux lois extra-territoriales américaines ou encore qu’elle souffre d’un excès de réglementation aggravé par des sur-transpositions nationales.
Tout ceci est rigoureusement exact, mais aussi graves soient-ils, ces problèmes ne sont que des symptômes. Pour les guérir et sortir l’Europe de la plus grave crise de son histoire, il faut remonter à l’origine de ces difficultés et tenter d’en saisir la cause profonde. De quels maux l’Union européenne souffre-t-elle qui l’empêchent de trouver les solutions adéquates aux défis majeurs auxquels elle doit faire face ? J’en vois trois.
Le premier, c’est la « construction européenne » elle-même.
Depuis plus de soixante-dix ans, l’Europe est en perpétuelle construction. Comme une maison toujours inachevée, dont les habitants débattraient ad nauseam du nombre d’étages ou de l’utilité finale des pièces. De traité en référendum et de conseil en sommet, l’Europe semble victime d’un mouvement brownien fait de réformes institutionnelles, d’élargissements géographiques (13 nouveaux membres entre 2004 et 2013 !), d’extension de ses compétences et de production de nouvelles normes et réglementations.
Et ce mouvement permanent, loin d’être vécu comme un inconfort, devient parfois pour nos responsables une feuille de route, une doctrine, voire une raison d’être. Tout fonctionnaire ou élu européen qui se respecte doit participer à la construction européenne, c’est-à-dire ajouter sa pierre à l’édifice, sa couche d’institution, d’élargissement, de compétence ou de réglementation. A tel point que l’Histoire de l’Union européenne est enseignée davantage au travers des traités (de Rome à Lisbonne, en passant par Maastricht, Amsterdam…), qu’au travers de ses réalisations pourtant nombreuses. Comme si le contenant importait plus que le contenu. Pour que l’Europe vive, il faut qu’elle avance. Toujours. Sinon elle tombe. C’est la parabole du cycliste.
Sauf que cette parabole n’est pas seulement fausse, elle est aussi coupable. Elle a fait de notre Europe, à force d’en complexifier les règles et d’en densifier le contenu, le royaume des juristes et des lobbies. Et elle inspire, à tort, la plupart des propositions de nos responsables politiques qui voient dans les réformes institutionnelles et la révision des traités des passages obligés pour remettre l’Europe sur les rails. Rares sont ceux en France qui considèrent qu’il faut arrêter de toucher aux institutions et concentrer nos énergies sur les projets qui apporteront de vrais changements pour les Européens.
Le second mal de l’Europe, c’est l’attention excessive qu’elle a porté à sa construction interne, au détriment de sa capacité à affirmer son identité européenne et à faire face aux enjeux de la mondialisation.
Le marché unique européen est l’une des plus belles réussites de l’Union européenne. Les Britanniques qui s’apprêtent à le quitter en prennent peu à peu toute la mesure. Plus largement, les quatre libertés de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux sont les fondements d’un ensemble politique multinational unique au monde, dont nous pouvons être fiers.
Mais là où le bât blesse c’est que la constitution de ce marché unique a totalement accaparé les esprits pendant des décennies, au détriment de notre capacité collective à affirmer son identité et à adresser le monde extérieur. Comme si l’Europe, trop concentrée sur elle-même, avait oublié qu’elle n’était qu’un ensemble parmi d’autres, dans un monde plus vaste au sein duquel évoluaient d’autres puissances poursuivant d’autres intérêts. Comme si en se renforçant de l’intérieur, l’Europe avait créé simultanément les sources de sa fragilité extérieure.
Nous avons ainsi imposé à nos entreprises des règles de concurrence parmi les plus exigeantes au monde, alors même que leurs homologues américaines ou asiatiques ne sont pas nécessairement soumises aux mêmes obligations.
Nous avons favorisé le libre-échange et ouvert notre marché européen aux entreprises de pays tiers, sans toujours exiger de nos partenaires commerciaux une ouverture réciproque de leurs propres marchés.
Nous avons bâti un modèle social et environnemental parmi les plus avancés au monde et qui fait notre fierté, sans réussir à imposer à nos partenaires non européens le respect de normes équivalentes.
Nous avons favorisé la libre circulation des personnes au sein de notre espace européen, nous avons créé « Schengen », sans nous donner les moyens de contrôler efficacement nos frontières extérieures et les flux d’immigration non désirés.
Nous avons construit les bases d’une paix durable en Europe, sans nous donner les moyens collectifs de projeter nos forces hors de nos frontières lorsque notre sécurité l’exige.
Ne soyons pas surpris dès lors que l’attente principale de nos concitoyens à l’égard de l’Europe soit que celle-ci les protège. Ils ne veulent pas d’une Europe parfaite à l’intérieur mais vulnérable de l’extérieur. Ils veulent une Europe capable de défendre les intérêts européens face aux menaces terroristes, aux risques migratoires, environnementaux et commerciaux. Là aussi, nos responsables nationaux et européens doivent opérer une forme de révolution mentale : dans les années à venir, le salut de l’Europe passera moins par sa capacité à parachever son marché unique et ses politiques communes que par sa capacité à démontrer son efficacité face aux enjeux multiples de la mondialisation.
Le troisième mal dont souffre l’Europe, c’est l’absence de leadership.
Quand l’Europe balbutie et peine à décider, il est facile d’incriminer sa gouvernance complexe et le nombre trop élevé de ses Etats membres. Incontestablement, les élargissements nombreux et rapides à partir de 2004 ont rendu la tâche du Conseil européen plus complexe. Arguant d’une double fracture Est/Ouest (sur les questions migratoires) et Nord/Sud (sur les questions économiques et monétaires), nombreux sont ceux qui prônent une Europe des « cercles concentriques » pour contourner les difficultés et avancer malgré tout. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle.
Si l’idée est un rétrécissement de l’Europe à 6, 8 ou 12, alors le risque est grand de la faire disparaître totalement. L’annonce d’une telle décision – si tant est que les partenaires envisagés par la France pour faire partie du noyau dur l’acceptent – provoquerait immédiatement l’annonce de coalitions concurrentes. Au « cœur d’Europe » ouest européen répondraient immédiatement une Europe de Višegrad autour des Polonais et Hongrois, ou une Europe nordique et baltique ou encore une Europe des Balkans, sans doute sous influence turque ou russe. Et la position de l’Allemagne serait particulièrement délicate car rien ne dit qu’elle accepterait ce découpage à hauts risques. L’Europe des cercles concentriques est finalement une vision très française.
Si l’idée en revanche est de s’appuyer sur les structures et procédures existantes, comme la zone euro, les coopérations renforcées ou les projets intergouvernementaux, alors oui bien sûr il faut exploiter toutes ces marges de manœuvre, bien plus que nous ne le faisons actuellement, et permettre ainsi aux Etats membres qui le souhaitent d’avancer plus vite et plus loin.
Mais quel que soit le périmètre dont on parle, l’enjeu principal n’est pas le nombre d’États membres mais l’existence d’un leadership, c’est-à-dire la capacité de quelques Etats membres à convaincre les autres de l’intérêt de travailler ensemble. Reconnaissons que le président de la République a donné en la matière une impulsion inédite dès son élection, mais que l’absence de partenaire solide outre-Rhin a quelque peu douché nos espoirs d’une relance de l’Europe grâce au couple franco-allemand.
La France peut-elle reprendre ce leadership avec une chancelière allemande affaiblie, un gouvernement italien franchement hostile au Président français et une Europe centrale et orientale en rupture avec les valeurs fondamentales de notre Union ?
Ce sera tout l’enjeu des prochains mois. C’est à mon sens encore possible à la double condition. 1. Instaurer un moratoire de 10 ans sur les réformes institutionnelles, les élargissements géographiques et les extensions de compétence. 2. Provoquer un électrochoc en proposant à nos partenaires la tenue d’un conseil européen exceptionnel pour aboutir à des propositions concrètes et budgétées sur trois sujets vitaux pour les Européens, à savoir l’autonomie européenne en matière de défense, la maîtrise de l’immigration et le rattrapage de notre retard en matière d’innovation, par exemple en matière d’intelligence artificielle. Trois sujets qui ne couvrent pas tous les champs possibles bien entendu, mais qui enverraient à nos concitoyens avant les prochaines élections européennes un signal très clair quant à l’utilité de l’Union européenne.
Moins de réformes institutionnelles, moins de réglementation, plus de réalisations concrètes. C’est en passant de la « construction européenne » aux « réalisations européennes » que l’on regagnera la confiance de nos concitoyens et que l’on pourra espérer voir renaître le sentiment d’une communauté de destin.
Jacques Beltran est chargé des affaires européennes et internationales à la Région Ile-de-France.
Brexit: holding out hope for pragmatism, and a miracle
22 September 2018
Prince Michael of Liechtenstein, GIS Reports
The European Union’s heads of state and government met in Salzburg last week, as Austria currently holds the rotating EU presidency. One of the main items on the agenda was a discussion with United Kingdom Prime Minister Theresa May on Brexit.
Prime Minister May negotiated based on her “Chequers” proposal, a British plan for an orderly exit from the EU, assuring free trade but not a free exchange of people. The plan has been in discussion for a while now. Mrs. May, however, has very little room to make any further compromises, due to her government’s fragile position domestically.
The EU side showed a lack of pragmatism, giving Mrs. May a “take it or leave it” offer. Unlimited freedom in exchanging goods, capital and services is always desirable in a trade relationship. For the EU, this free exchange is unacceptable if it is not linked with the free exchange of people.
For those who think logically and pragmatically, it would appear more desirable to maintain the free exchange of goods, services and capital, even without the free exchange of people, than to have none at all. By all appearances, logic was nowhere to be found at the discussions in Salzburg. Instead of a constructive discussion, we witnessed a celebration of bureaucratic fundamentalist ideology. It was embarrassing.
But there is a lot at stake, not only for the UK, which is a crucial trading partner for most EU countries. The argument that access to the internal market can only be granted when all conditions are fulfilled was elevated to dogma, even though it neglects the negative consequences.
It also fails to take into account that the biggest promoters of the “everything or nothing” position are the same people who have recently tried to limit the EU’s economic freedoms and curb internal competition when it suited their interests. French President Emmanuel Macron, for example, uses minimum wages and social security pretexts in an attempt to limit the posting of workers, mainly from Central European businesses, throughout the union. In another example, last year his governmentseized French shipyards to block their acquisition by an Italian company.
Fading optimism
Until now, one could have been optimistic and believed that finally, some reasonable decision makers would have pushed for more flexibility, not only in the interest of European economies. Europe is built on diversity, and the future of the EU will depend on the ability to respect and take advantage of this diversity. Unfortunately, the approach of increasing harmonization and the insistence that “one size fits all” is killing the European spirit and sapping its strength.
As opposed to political fundamentalism, business thinking tends to be pragmatic and logical. What business often neglects to take into account, however, is the irrationality of bureaucratic politics. So far, businesses have believed that a mutually acceptable solution to Brexit would be found. Expecting businesses to invest huge sums to prepare for the bizarre alternative is asking a lot. Some will be caught unprepared.
The EU leaders in Salzburg have set October 18 as the deadline to resolve the impasse – not even four weeks. A miracle could still happen, although by definition, miracles are rare.
Multilatéralisme : vers la fin de l’ordre occidental
ANALYSE. L’assemblée générale des Nations unies s’est ouverte lundi à New York sans les dirigeants chinois, indien et russe. Un signe supplémentaire que l’ordre international tel que nous le connaissons a vécu : son épicentre se déplace vers l’est, avec de nouvelles règles et un nouvel acteur majeur, la Chine.
Cette année, ni Xi Jinping, ni Narendra Modi, ni Vladimir Poutine ne seront présents à l’assemblée générale des Nations unies à New York. La Chine et l’Inde seront pourtant les puissances démographiques et économiques majeures du XXIe siècle, et la Russie est une puissance régionale qui compte, grâce à son engagement militaire. Ces absences font mieux que souligner en creux la perte d’influence de l’organisation, elles mettent en lumière un fait majeur : un autre ordre multilatéral est en train de naître, dont l’Occident sera cette fois le parent pauvre.
On aurait pu avoir l’impression, depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, que les Etats-Unis étaient les champions de la charge contre le multilatéralisme. Avec son programme d’« America First », où la relation bilatérale et le protectionnisme sont préférés , le président américain n’a ménagé ses coups de boutoir à aucune institution, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aux Nations unies. Convaincu que ces arrangements entre amis lui rapportaient finalement assez peu, il préfère améliorer son jeu en profitant du rapport de force dont il dispose.
Deux chocs
En réalité, la déliquescence de l’organisation de l’ordre mondial telle que nous la connaissons est plus ancienne. Elle date de deux chocs successifs. Celui du 11 septembre 2001, puis de la crise financière de 2008 , qui ont débouché sur une « contestation de l’ordre occidental », explique le diplomate Jean-David Levitte. Jusque-là, les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) avaient profité de la globalisation pour moderniser leurs économies et asseoir leur statut de puissances émergentes. L’attentat du 11 septembre est perçu comme un refus des valeurs libérales occidentales, tandis que la crise financière – dont les économies émergentes vont être une des premières victimes – les ébranle profondément. Si elles ont été favorables à la mondialisation, elles souhaitent désormais en réécrire les règles. En commençant par refuser l’occidentalisation. D’où l’hindouisme triomphant de Modi ou l’exaltation de la Turquie de Soliman par Erdogan.
Arrimés à la Chine
Cela est possible grâce à la formidable locomotive qu’est devenue la Chine, derrière laquelle beaucoup de pays souhaitent s’arrimer. En quarante ans, elle s’est profondément enrichie et transformée. Sa nouvelle puissance lui permet de réorganiser l’ordre international comme elle le voit, autour de l’empire du Milieu. Elle veut devenir le leader technologique du XXIe siècle, se réarme et se crée des obligés et des débouchés sur la moitié de la planète avec son programme « one belt, one road » . Elle finance la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, qui entend marcher sur les plates-bandes du FMI comme de la Banque mondiale.
Enfin, la Chine soutient de nouvelles instances intergouvernementales, comme l’Organisation de coopération de Shanghaï . Conçue comme une réponse à l’effondrement de l’URSS qui promeut la coopération économique et sécuritaire, celle-ci réunit la Russie, la Chine, le Kazakstan, le Kirghizistan, le Tadjkistan et l’Ouzbékistan. L’an passé, elle a accueilli l’Inde et le Pakistan. Au final : 3,2 milliards d’habitants et un PIB combiné de 37.000 milliards de dollars. Et, contrairement aux Etats-Unis, la Chine continue d’investir dans les organisations internationales de l’après-guerre, réclamant ou conquérant davantage de poids autant au FMI qu’aux Nations unies, et profite à loisir de la tribune de Davos.
Nouvel épicentre
Le multilatéralisme est donc loin d’être mort. Mais son épicentre a bougé. Il n’est plus sur la 47e rue Est à New York, qui a démontré son impuissance à résoudre les conflits, notamment la crise syrienne. Surtout, les solidarités et les ambitions sont différentes. Les émergents se tiennent les coudes et se retrouvent sur des valeurs anti-occidentales, et surtout non interventionnistes. L’Inde est collée à la Russie, la Chine anime une coalition hétéroclite d’obligés, du Pakistan à la Corée du Nord. De nombreux pays d’Afrique ou d’Amérique latine peuvent y trouver leur compte, soit par intérêt économique, soit par anti-américanisme. Poutine s’intéresse davantage à l’organisation de Shanghai qu’à réintégrer un G8 dont il sait que la France et le Royaume-Uni seront sortis dès 2030 pour faire la place, d’ici à 2050, à l’Indonésie, au Brésil et au Mexique. Pour les Occidentaux, expliquait récemment Hubert Védrine aux « Echos » , « il est urgent de trier entre ce qui est fondamental et ce qui peut relever d’un compromis avant que les Chinois ne nous mettent devant le fait accompli ».
Alliances tactiques
Dans son dernier ouvrage, « Quand le Sud réinvente le monde » (La Découverte), l’expert en relations internationales Bertrand Badie décrit la fin d’un système international westphalien – qui tire son nom de la paix de Wesphalie en 1648, et qui s’organisait autour d’Etats, de souveraineté, de territorialité. A la faveur de la globalisation, explique-t-il, « on découvre que la stabilité internationale ne dépend plus tellement de l’équilibre de puissances, mais de l’équilibre très précaire des conditions sociales. Autrement dit, le positionnement du faible et son excès d’impuissance deviennent presque mécaniquement la source des grandes menaces qui pèsent sur la stabilité de l’ensemble. »Le printemps arabe et ses conséquences, la crise grecque qui a menacé l’édifice européen, en sont des illustrations. L’auteur note également que, désormais, l’acteur régional, voire l’acteur local, détient plus de capacités que l’acteur mondial. Pour preuve, Iran, Turquie, mais aussi groupes terroristes ont une capacité d’action supérieure à celle de puissances mondiales dans le conflit syrien.
Lors de son discours aux ambassadeurs , fin août, Emmanuel Macron constatait lui-même que « les nationalismes se sont réveillés. L’Europe affadie est affaiblie. Le système multilatéral est remis en cause par des acteurs moyens et des régimes autoritaires. » Le président français a néanmoins une réponse « pour une refondation en profondeur de notre ordre mondial ». Il s’agit de construire des alliances tactiques pour « la protection des biens communs mis en danger par la crise du multilatéralisme et la politique des Etats-Unis ». Climat, éducation, santé, espace numérique, commerce international : une stratégie multilatérale qui se gère chapitre par chapitre, et qui dépasse les seuls Etats, puisqu’il est impératif, à l’instar de la COP 21, d’inclure un maximum d’acteurs non étatiques.
Entretien avec Thierry de Montbrial, président de l’Institut français des relations internationales
«La grande affaire pour les 30 prochaines années sera la rivalité entre la Chine et les États-Unis»
Invité par l’Académie du Royaume du Maroc et l’OCP Policy Center, le président de l’Institut français des relations internationales (Ifri), Thierry de Montbrial, livre pour les lecteurs du «Matin» une analyse globale des futurs enjeux géopolitiques dans le monde et de leurs principaux protagonistes. Il évoque au passage le rôle que le Maroc est appelé à jouer dans le partenariat entre l’Afrique et l’Union européenne et nous donne un avant-goût de la 11e édition de la World Policy Conference prévue en octobre prochain à Rabat.
Le Matin : Vous êtes économiste, géopolitologue, professeur, président et fondateur de l’Institut français des relations internationales, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, président de la World Policy Conference… et vous avez bien d’autres casquettes. Quelle est celle qui vous tient le plus à cœur ?
Thierry de Montbrial : Je crois que tout cela est lié. Cela procède d’un intérêt pour le monde et d’un désir farouche d’être utile pour les grands enjeux des années et décennies qui viennent pour voir comment maintenir un monde que j’appelle raisonnablement ouvert. Car c’est cela le grand enjeu du 21e siècle. Je voudrais aussi signaler que la World Policy Conference, qui existe maintenant depuis 11 ans, tiendra ses débats pour la quatrième fois au Maroc, à Rabat, fin octobre.
À travers l’Ifri, que vous avez fondé en 1979, vous publiez régulièrement le Ramsès (Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies), mais également la revue «Politique étrangère» créée par le Centre d’études de politique étrangère en 1936 et qui a été reprise et publiée par l’Ifri en 1979. Quel est l’apport de ces deux importants documents ?
«Politique étrangère» est une revue classique dans les relations internationales qui paraît tous les trois mois et qui couvre beaucoup de sujets, mais qui sont traités d’un point de vue européen. Les grandes revues américaines en la matière traitent ces sujets d’un point de vue américain. C’est pour cela qu’il faut avoir la pluralité des points de vue. Quant au Ramsès, il s’agit d’un document annuel qui, tous les ans depuis 36 ans, fait une sorte de tour du monde. C’est un livre qui porte sur l’état de la planète. Si on prend tous les Ramsès depuis le premier numéro en 1981, on peut avoir comme une espèce de film qui montre comment le monde a évolué depuis maintenant 37 ans. Chaque année, on essaye de faire le point. Moi-même, j’apporte des analyses d’ensemble dans ce rapport. Par exemple, aujourd’hui, il y a la conséquence des rivalités entre la Chine et les États-Unis et bien d’autres sujets. Nous privilégions certains thèmes, par exemple, cette année nous traitons les questions démographiques, les questions de migration, les réfugiés, la question du Moyen-Orient, l’Iran… Nous traitons également le sujet de la Chine qui retiendra notre attention pendant longtemps.
La première partie du rapport Ramsès est réalisée par vous. Elle a été consacrée aux «Perspectives», est-ce en relation avec le titre de cette édition «Les chocs du futur» ?
En fait, je pars de l’idée que la grande affaire pour les 30 prochaines années va être la rivalité entre la Chine et les États-Unis qui peut déboucher sur plusieurs scénarios. La question majeure est donc de savoir où se situe l’Europe. Ce n’est pas intéressant uniquement pour les Européens, mais également pour le reste du monde, en particulier pour votre pays, pour l’Afrique et l’Afrique du Nord qui est à la porte de l’Europe. Tout ceci conduit aussi à analyser de plus près les forces immédiates. Il s’agit par exemple de la situation au Moyen-Orient, la Corée ou des évolutions en Asie. Mais j’accorde cette année aussi une place importante aux questions idéologiques, les régimes politiques, la démocratie, la démocratie libérale, la démocratie «illibérale»… Des sujets qui sont de plus en plus débattus et qui me paraissent essentiels pour l’avenir du monde. Il faut admettre l’hétérogénéité du monde et admettre qu’on est interdépendant avec des pays qui n’ont pas tous la même culture, n’ont pas les mêmes régimes politiques et il faut respecter cela. Sinon, cela ne peut que dégénérer, comme cela fut le cas au Moyen-Orient. Ces perspectives touchent donc à des sujets que je crois assez fondamentaux et durables.
Vous parlez également de l’importance de la construction de l’Europe. Dans ce cadre, et étant donné le statut avancé dont jouit le Maroc, ne pensez-vous pas qu’il y a un rôle à jouer par le Royaume, notamment celui de trait d’union entre l’Europe et l’Afrique ?
Je pense que le Maroc est bien évidemment un pays qui a une position de plus en plus privilégiée dans la relation entre l’Europe et l’Afrique. C’est d’ailleurs la direction dans laquelle le Maroc s’engage. Il a réintégré l’Union africaine, il a une politique ambitieuse de collaboration avec un certain nombre de pays africains. Je crois que c’est une bonne politique qui peut contribuer, sur la durée, à donner un sens de plus en plus riche au partenariat entre le Maroc et l’Union européenne.
Vous êtes également le président de la World Policy Conference, dont des éditions ont eu lieu au Maroc. La prochaine édition aura lieu à Rabat. Pouvez-vous nous donner un avant-goût du programme de cette onzième édition ?
C’est la 11e édition de la World Policy Conference (WPC). Le but de cette conférence est d’examiner l’évolution de la gouvernance mondiale. C’est un thème un peu abstrait. Mais le véritable enjeu c’est la capacité du monde à vivre ensemble et à gérer l’interdépendance entre les nations. Je mets l’accent, depuis le début, sur les puissances moyennes, parce que je crois qu’on ne peut s’en remettre exclusivement aux principales puissances, d’autant plus que ces grandes puissances ne s’intéressent plus au droit international et ont tendance à jouer uniquement avec des relations de pouvoir.
C’est pourquoi nous mettons, depuis le début, l’accent sur les puissances moyennes qui sont soucieuses et désireuses de contribuer à façonner positivement leur environnement. Nous traitons toujours les grands sujets géopolitiques et économiques, mais également d’autres sujets. Par exemple, cette année nous allons avoir une session sur l’importance de l’enseignement et de l’éducation dans les premières années. Ce débat sera animé par des personnalités éminentes venant de différents pays, notamment de l’Afrique et de l’Inde. Là, nous avons un exemple de sujets types non classiques, mais qui est très porteur pour l’avenir. Autre exemple de sujet un peu original, la question des religions en Chine puisque, actuellement, surtout depuis le dernier congrès du Parti communiste en Chine, le pouvoir persécute systématiquement les religions. Ce sont aussi des éléments de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Un dernier point, c’est que la World Policy Conference se veut comme une sorte de club, dans ce sens que ce n’est pas une énorme conférence où tout le monde vient. C’est plutôt un cadre où les gens sont invités un à un avec un nombre relativement limité. C’est un club global et nous sommes très heureux de tenir cette édition, pour la quatrième fois (sur 11 éditions), au Maroc. D’ailleurs, le Royaume s’est intéressé dès le début à la WPC et je crois que le Maroc a une excellente sensibilité à ce genre de thèmes et je le remercie d’accueillir cette conférence.
Brian Gallagher
PDG de United Way Worldwide, le plus important organisme privé à but non lucratif au monde. Sous la direction de M. Gallagher, United Way fait figure de chef de file mondial en termes de changement communautaire, une approche qui rassemble les gens pour créer plus d’opportunités pour tous. En 2002, M. Gallagher est devenu président et PDG de United Way of America, qui a fusionné avec United Way International pour former United Way Worldwide en 2009. Soutenu par près de 3 millions de bénévoles et 9 millions de donateurs, United Way se bat pour la santé, l’éducation et la stabilité financière dans près de 1 800 communautés à travers le monde.
Georges Ghosn
Journaliste, Président Groupe de Presse. En 1992, il a racheté puis il a fusionné La Cote Desfossés avec La Tribune, pour créer La Tribune Desfossés. La diffusion de La Tribune est ainsi passée de 43 500 à 70 457 exemplaires payants. En 1996, Georges Ghosn, associé à Claude Solarz, un industriel spécialisé dans la récupération de vieux papiers, a repris Le Nouvel Économiste. A compter de 2012, il a repris une activité de restructuration d’entreprises et a racheté Swisscosmetics Ch. En juin 2018, il a racheté le magazine hebdomadaire VSD au groupe Prisma Presse.
Responsabiliser la finance mondiale pour éviter une nouvelle crise
LE CERCLE/POINT DE VUE – Dix ans après la crise des subprimes, la finance ne dispose toujours pas d’une régulation holistique efficace et d’une approche consolidée des risques. Il faut encourager la bonne allocation du capital au niveau mondial.
La crise financière de la livre turque, qui a menacé de s’étendre aux pays émergents et au secteur bancaire européen, a rappelé la totale interdépendance du système financier mondial. Dix ans après la crise des subprimes, la finance, malgré des progrès importants, ne dispose toujours pas d’une régulation holistique efficace et d’une approche consolidée des risques.
Surtout, la dynamique de l’endettement souverain dans un nombre important de pays, les taux d’intérêt proches de zéro, les incertitudes sur la sortie du « QE » comme le développement des fonds vautours, spécialisés dans le rachat de dettes émises par des débiteurs en difficulté, et des fonds activistes qui spéculent sur les sociétés, créent une instabilité dommageable à la stabilisation de l’économie mondiale. L’incapacité à responsabiliser la finance entretient une instabilité structurelle et pourrait préfigurer une nouvelle crise de grande ampleur.
Actions spéculatives
A un niveau plus microéconomique, les entreprises sont touchées par l’arrivée, au capital, de fonds activistes qui jouent à la baisse sur les actions et spéculent sur la restructuration des actifs, à l’instar de Vivendi ou Danone. Au premier semestre 2018, 104 fonds activistes ont lancé 145 raids sur 136 entreprises à travers le monde avec un montant de capital engagé de 40 milliards de dollars.
Ces opérations se concentrent de manière croissante sur le terrain européen selon la dernière étude de la banque Lazard, notamment pour les fonds qui spéculent sur la baisse des actions en les vendant à crédit pour les racheter plus tard en réalisant un bénéfice. Ces fonds n’hésitent pas à financer des études biaisées, qui contribuent à la chute des cours, à influencer la presse avec des forums, voire à tromper les algorithmes sur Internet.
Les difficultés à contrer de telles actions spéculatives sont nombreuses, notamment l’incapacité intellectuelle à articuler un discours cohérent sur la refondation de la finance mondiale, sans toucher pour autant à la mondialisation et à la libéralisation des marchés. Pourtant, le rôle de la finance est simple : assurer le financement de la croissance, garantir la sécurité de l’épargne, payer une prime à la hauteur du risque pris par les investisseurs, permettre de gérer le temps, l’espace et les risques associés.
Or jusqu’à présent, les réformes ont été réalisées de manière fragmentée, sans développer de vision globale du système financier qui permette de relever les grands défis que sont notamment le développement durable et la lutte contre le changement climatique.
« Do good and do well »
A une période où les risques s’accumulent, il faudrait relancer une réflexion d’ensemble sur l’architecture mondiale de la supervision financière au sein du G20 dont le Financial Stability Board fête son dixième anniversaire.
Comment favoriser une bonne allocation du capital au niveau mondial ? On pourrait envisager en son sein une réflexion sur les obstacles au financement du long terme et du développement durable ou le voir travailler à la promotion du « do good and do well » (« faire bien et comme il faut », en français), afin que notamment les particuliers – épargnants retraités investisseurs – soient rassurés sur l’usage de leur épargne et que les investisseurs en général aient accès à un univers d’opportunités le plus vaste possible et se sentent encouragés à revoir leurs politiques.
C’est avec des mesures de responsabilisation, au-delà du « tout-réglementaire », que seront jugés les dirigeants des démocraties et les acteurs financiers alors que le populisme continue à se nourrir d’actions spéculatives qui révoltent les opinions publiques. Beaucoup a été discuté. Il y a plus encore à faire.
Ne soumettons pas l’Europe à la noire dialectique progressistes / nationalistes
CHRONIQUE – La procédure visant à priver la Hongrie de ses droits de vote au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne est excessive sur le fond, inefficace sur la forme, et contre-productive sur le long terme.
Nombreux sont les responsables européens à s’être réjouis du vote du Parlement de Strasbourg du 11 septembre 2018 qui, suivant la proposition d’une députée écologiste hollandaise, a ouvert une procédure visant à priver la Hongrie de ses droits de vote au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne (UE). Ils ont eu tort. Car, sans le vouloir, ils sont en train d’affaiblir la cohésion d’une UE qui, après le Brexit, n’avait pas besoin de cela.
Le vote européen est excessif sur le fond, inefficace sur la forme, et contre-productif sur le long terme. Sur le fond, on a bien sûr le droit de combattre la politique du premier ministre hongrois. On a le droit de détester les idées de M. Orban, son style, son visage. On peut lui reprocher d’être trop « nationaliste ». On peut même, si l’on veut, le qualifier de « populiste », quitte à courir le risque de se voir opposer cette définition : est populiste celui qui n’a pas les mêmes idées que moi mais qui est plus populaire que moi et qui engrange davantage de voix que moi. On peut surtout, dans le régime parlementaire qui est celui de la Hongrie, voter contre Orban aux élections législatives, qui s’y déroulent sans la moindre fraude tous les quatre ans. Aux élections d’avril 2018, où la participation fut très élevée, la liste de centre-droit de Viktor Orban a obtenu 49% des voix et 133 députés sur 199. Le parti MSZP de centre-gauche, avec 12% des voix, a conquis 20 sièges. Le parti Jobbik, ultra-nationaliste, a obtenu 19% des voix et conquis 26 sièges. Le parti écologiste LMP a obtenu 7% et 8 sièges.
Faut-il le répéter ? Orban n’est pas Hitler. En Hongrie, vous pouvez dire ce que vous pensez publiquement, vendre les livres que vous voulez, lire les journaux que vous aimez, et faire campagne dans la rue contre Orban. Il ne vous arrivera rien. Si vous êtes juif et que vous habitez une banlieue de Budapest, vous pouvez pratiquer votre religion en toute quiétude. En Seine-Saint-Denis, ce n’est, en revanche, plus le cas. S’il y a un scandale de libertés publiques et d’Etat de droit en Europe, c’est bien en France qu’on le trouve. Il est proprement scandaleux que, dans certaines banlieues de France, un Juif ne se sente pas en sécurité, doive raser les murs, sous prétexte qu’il porte une kippa sur la tête. Avant de donner des leçons à l’Europe entière, la France serait bien avisée de balayer devant sa porte.
En 2015, sans consulter ses partenaires européens, la chancelière d’Allemagne a décidé d’ouvrir grand ses frontières aux migrants venus du Moyen-Orient et d’Asie centrale, provoquant un appel d’air sans précédent vers tous les miséreux de la planète. On a tout à fait le droit de louer le grand cœur de Mme Merkel, et de penser que cette immigration sans visa est une chance pour l’Europe. Mais doit-on pour autant refuser d’entendre les arguments de M. Orban qui, avec ses partenaires du Groupe de Visegrad, ne veut recevoir que des réfugiés chrétiens, estimant que l’intégration des populations musulmanes ne se fait pas de manière satisfaisante dans les sociétés d’Europe de l’Ouest ?
Il serait légitime que l’Allemagne et la France veuillent arrêter de financer à Bruxelles les programmes structurels en Europe de l’Est, afin de consacrer cet argent à la lutte contre les circuits de trafic d’êtres humains en Afrique du Nord et aux politiques de développement des investissements productifs en Afrique noire. L’immigration illégale est devenue en effet la première urgence de l’UE.
Mais il est illégitime de vouloir sanctionner à ce point (par la privation de ses droits de vote) la Hongrie, alors qu’elle n’a fait, depuis 2015, qu’appliquer strictement les accords de Schengen. Pourquoi les frontières européennes devraient être les seules du monde à pouvoir être, impunément, franchies illégalement ? Les pays européens n’entretiennent-ils pas un réseau d’ambassades et de consulats à travers le monde, ouverts à toute demande légitime de visa ?
Sur la forme, la procédure du Parlement européen n’a aucune chance d’aboutir car il lui faudrait l’unanimité des votes au sein du Conseil. Or la Pologne a déjà fait savoir qu’elle voterait non. A court terme, il s’agit donc de beaucoup de bruit pour rien.
Mais à moyen et long terme, ce geste du Parlement est contreproductif. S’il avait voulu accroître les divisions au sein des nations de l’Union européenne, le Parlement n’aurait pas agi différemment. Ce n’est pas en diabolisant l’Italie et le Groupe de Visegrad (Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne) qu’on fera progresser l’Union européenne. Vouloir défendre l’identité des vieilles nations chrétiennes de l’Europe n’est tout de même pas un crime ! Comme n’est d’ailleurs pas un crime la volonté de se montrer accueillants envers des familles étrangères dans la détresse. Il y a un simplement un équilibre à trouver entre la défense de sa culture et une politique d’accueil des étrangers qui ne la mette pas en danger.
Ne jetons pas dans les bras des partis nationalistes antieuropéens tous ces citoyens qui aiment la construction européenne mais qui sont opposés à une immigration de masse, lui préférant une immigration choisie. Ne soumettons pas l’Europe à la noire dialectique « progressistes » contre « nationalistes ». On peut accepter le progrès tout en aimant sa nation, son histoire, sa civilisation.
Evitons que cette dialectique délétère fasse désormais système dans le paysage politique européen. Renforçons la cohésion de l’Union. Car, en tant que Français, nous avons besoin d’une Europe forte et unie, d’une Europe qui soit capable de résister à l’hégémonisme financier et juridique américain, ainsi qu’au dumping commercial et au pillage technologique venus de Chine.
Depuis le Brexit, la santé de l’UE n’est pas bonne. Gardons-nous de la dégrader davantage.
Staffan de Mistura
Staffan de Mistura a été nommé Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie en juillet 2014. Auparavant, il a notamment été Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq (2007-2009) et l’Afghanistan (2010-2011), et Vice-ministre italien des affaires étrangères. Au cours d’une carrière de plus de quarante ans au sein d’organismes des Nations Unies, il a servi dans de nombreuses zones de conflit et dirigé opérations de secours complexes, distributions alimentaires et campagnes de vaccination. Il a notamment été affecté au Soudan, en Éthiopie, en Albanie, en Afghanistan, en Iraq, en Bosnie et en Somalie. Il a également occupé de hautes fonctions politiques et humanitaires au Liban et en Irak, et a été Directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial. M. de Mistura a la double nationalité italienne et suédoise et parle sept langues.
Jean-Yves Le Gall : « Trois programmes militaires spatiaux sont encore dans les cartons »
Bertrand Badré: «La plus grosse perte engendrée par la crise financière c’est celle du capital-confiance»
14 septembre 2018
Propos recueillis par Irène Inchauspé
« Personne n’a vraiment songé au modèle d’après-crise : quelle type d’économie veut-on financer et comment ? »
Bertrand Badré est fondateur et PDG de «Blue like an Orange Sustainable Capital». Il a été auparavant directeur général finances de la Banque Mondiale, directeur financier de la Société Générale et du Crédit Agricole. En 2016, il a publié «Money Honnie : et si la Finance sauvait le monde ?»
Comment expliquer la détestation farouche de la finance qui a suivi la crise de 2008 ?
Cette crise financière et la grave récession qui a suivi ont fait de la finance l’ennemi à abattre. Pour bien comprendre son effet dévastateur, il faut se rappeler ce dont on parlait en France à l’été 2008. Le thème qui dominait était le débat autour du revenu national d’activité (RSA) proposé par Martin Hirsch. On discutait alors de savoir quel budget y consacrer : 500 ou 600 millions d’euros ?
Lire la suite sur le site de l’Opinion.
« Emmanuel Macron doit faire le pari de la Russie »
Interview de Renaud Girard
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-CLAUDE GALLI | LE COURRIER INTERNATIONAL DE RUSSIE | 12 SEPTEMBRE 2018
Emmanuel Macron a annoncé début juillet l’organisation, les 11, 12 et 13 novembre prochains, d’un grand Forum sur la Paix à Paris, dans le cadre de la célébration du centenaire de l’armistice de 1918. Il y a convié les chefs d’État des pays ayant participé à la Première Guerre mondiale, dont Vladimir Poutine et Donald Trump. Certains, à Paris et Moscou, évoquent, à cette occasion, la tenue d’un mini-sommet entre les trois présidents. Par ailleurs, le 27 août, lors de la conférence annuelle des ambassadeurs, Emmanuel Macron a appelé à une « remise à plat des relations russo-européennes » et à l’ouverture de discussions avec Moscou sur la sécurité en Europe. Le chroniqueur de politique internationale du Figaro, Renaud Girard, qui a rencontré le président Poutine lors de sa venue à Versailles en mai 2017 et accompagné, cette année, le président Macron à Saint-Pétersbourg, commente pour le Courrier de Russie, ces dernières évolutions diplomatiques.

Le Courrier de Russie : Emmanuel Macron vient de proposer une « remise à plat » des relations russo-européennes. S’agit-il d’une inflexion majeure de la politique étrangère française ou d’une déclaration de bonne intention ?
Renaud Girard : Après plus d’un an d’exercice du pouvoir, il convient désormais de juger la politique d’Emmanuel Macron à ses actes. En ce qui concerne les relations avec la Russie, je suis de ceux qui estiment que la politique de sanctions européennes est contre-productive. Je ne pense pas que l’on puisse faire changer la stratégie d’un pays comme la Russie ‒ un pays qui a résisté pendant plus de mille jours au siège de Leningrad par l’armée allemande ‒ avec de simples sanctions commerciales. Mais, par ailleurs, je devine chez les Russes un désir de rapprochement avec les Européens. Je crois que les Russes ne sont pas ravis d’être rejetés par les Occidentaux dans les bras des Chinois.
Malgré les erreurs commises de part et d’autre et malgré la paranoïa qui peut régner dans les états-majors russes, comme dans la presse et les états-majors occidentaux, l’intérêt à moyen et long termes du vieux continent, est de ramener la Russie dans la famille européenne… qu’elle n’aurait jamais dû quitter, puisque depuis Pierre le Grand, il y a eu cette décision stratégique de l’ancrer à la civilisation européenne. Il me semble que le président Macron n’est personnellement pas très favorable aux sanctions. Il sait bien que ses partenaires italiens, espagnols, tchèques, hongrois, grecs et de nombreux autres pays de l’Union européenne, y sont également hostiles. Aujourd’hui, chez les pro-sanctions, on ne trouve plus que la Hollande, l’Allemagne et la Suède, je n’en vois pas d’autres. Peut-être la Pologne et les pays baltes. Mais ce n’est pas dans leur intérêt non plus. Leur intérêt, c’est de faire du commerce avec la Russie.
« Je pense qu’à long terme, la vision gaullienne est la bonne, celle de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural. »
Il faut donc une politique et une diplomatie plus tranchées, qui renonce au « en même temps », qui prend des options. Et je suis favorable à une diplomatie qui ferait le pari de la Russie. On peut se tromper, certes. Le général de Gaulle, lui même, avait été très déçu par Moscou, lui qui avait misé sur la Russie avec son voyage de 1966 : on ne peut pas dire que l’expédition russe, deux ans plus tard à Prague, ait été un beau remerciement pour son audace.
Mais je pense qu’à long terme, la vision gaullienne est la bonne, celle de l’Europe de l’Atlantique à l’Oural. J’aurais aimé une politique de Macron qui fasse le même pari, qui persuade Angela Merkel ‒ parce que là les Hollandais et les Suédois auraient suivi ‒ d’abandonner ou, du moins, de réduire les sanctions européennes. J’ai l’impression que les Français attendaient les Italiens pour s’engager dans ce sens, puisque les Italiens avaient promis dans leur campagne électorale de demander la levée des sanctions. Ils n’ont pas eu le courage de le faire. N’oublions pas qu’il suffit qu’un pays ne veuille pas les renouveler pour qu’elles ne le soient pas.

LCDR : Certains, à Paris, estiment que cette « remise à plat » ressemble curieusement au reset [redémarrage] proposé en son temps par Barack Obama à Vladimir Poutine. Un reset des relations russo-américaines qui, on le sait, s’est soldé par un échec politique.
R.G. : Je ne crois pas à l’impossibilité d’un dialogue avec les Russes. Ils ont quand même donné beaucoup de gages à l’Occident récemment. Je veux parler de l’aide logistique qu’ils ont apportée aux États-Unis dans la première décennie du nouveau millénaire, pour la guerre américaine en Afghanistan. Il y a aussi, avec eux, une bonne coopération sécuritaire contre le djihadisme. Même aujourd’hui, en Syrie par exemple, Américains et Russes parviennent à se parler.
« Sébastopol est un port russe depuis aussi longtemps que l’Amérique est un État indépendant. »
Nous devons corriger les fautes commises de part et d’autre. Je pense que c’était une erreur d’agiter devant la Russie le chiffon rouge d’une possible intégration de l’Ukraine dans l’OTAN. Elle est inacceptable pour les Russes. Les Occidentaux ont également commis une invraisemblable erreur diplomatique en laissant tomber le magnifique accord intra-ukrainien du 21 février 2014, qu’ils avaient eux-mêmes négocié. On peut comprendre, du point de vue de Moscou, l’annexion de la Crimée : ils voulaient être sûrs que Sébastopol ne tomberait jamais entre les mains de l’OTAN. Sébastopol est quand même un port russe depuis aussi longtemps que l’Amérique est un État indépendant. Mais il y a eu, aussi, une erreur stratégique de la Russie : son intervention dans le Donbass. Je ne vois toujours pas quel était son intérêt. Il y a bien d’autres choses à faire dans cette immense Russie que de s’occuper du Donbass. C’est par leur faute que les Russes ont perdu l’amitié des Ukrainiens. La Crimée, à la rigueur, ça pouvait passer. Mais ils ont humilié à deux reprises l’armée de Kiev, en août 2014 et en janvier 2015.
Aujourd’hui, la priorité est de rétablir la paix dans cette région; de mettre un terme à cette absurde situation de tension dans nos relations avec la Russie. Il suffit d’aller à Moscou, de se promener au parc Gorki, pour comprendre à quel point la jeunesse russe est favorable à l’Occident, à quel point les Occidentaux, lorsqu’ils vont faire du tourisme en Russie, sont bien accueillis. Il y a une proximité, et il ne faut pas se laisser entraîner par les événements, les extrémismes, les miliciens…
LCDR : Vous dites que Berlin souhaite maintenir les sanctions contre la Russie. Mais dernièrement, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s’est prononcé pour un rapprochement avec Moscou, afin notamment de résister à l’extra-territorialisation du droit américain. L’Allemagne n’est-elle pas en train de supplanter la France dans le rôle d’intercesseur entre la Russie et l’Europe – et, au delà, de l’Occident –, qui est traditionnellement le sien ?
R.G. : En fait, toute l’Allemagne n’est pas antirusse. Angela Merkel a une politique très antirusse parce qu’elle a été profondément déçue par Vladimir Poutine. Elle estimait avoir des liens d’amitié avec lui…
LCDR : Il lui a menti.
R.G. : Poutine lui a menti sur la Crimée, elle ne le lui a pas pardonné. Les chrétiens-démocrates sont traditionnellement plus antirusses. En revanche, les sociaux-démocrates allemands, et les autres partis, d’ailleurs, n’ont strictement rien contre la Russie. Ils estiment, au contraire, qu’il faut que l’Allemagne fasse encore davantage de business avec elle.

Pour ce qui est du paysage politique français, il faut se rappeler que des quatre candidats majeurs du premier tour de la dernière élection présidentielle ‒ ceux qui ont obtenu plus de 20% des voix ‒, trois sont ouvertement prorusses. Emmanuel Macron est le seul à ne pas l’être. Depuis son élection, il a indéniablement fait un pas vers la Russie, mais dans la vie il faut savoir parfois prendre des risques. Je trouve que sa diplomatie à l’égard de Moscou est amicale, et il a raison sur ce point. Simplement, elle ne va pas assez loin. Je ne demande pas à la France de reconnaître l’annexion de la Crimée. Ce ne sera possible qu’après un accord entre l’Ukraine et la Russie, c’est évident. Mais je pense que l’on pourrait faire le pari de la suppression des sanctions et voir ce qui se passe après.
Il y a des options à prendre, il faut se montrer courageux. C’est ce que la France radical-socialiste n’a pas su faire en 1935. C’était une époque difficile, le régime de Staline n’était pas très attrayant mais, quand les Anglo-Saxons nous ont laissé tomber sur la question de la remilitarisation de la Rhénanie, nous aurions du faire le pari d’une alliance de revers avec la Russie contre l’Allemagne. Ce n’était pas facile et je ne suis pas sûr que Staline ait été particulièrement disposé à s’engager avec nous… Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas essayé. C’est une erreur stratégique que Félix Faure n’avait pas commise avant la Première Guerre mondiale.
« L’Amérique a renoncé au triangle stratégique de Kissinger, qui postulait que Washington devait toujours être plus proche de Moscou et de Pékin que Moscou et Pékin entre elles. »
Aujourd’hui, dans le monde tel qu’il est, face notamment à la montée en puissance de la Chine avec ses politiques de « Routes de la soie », je ne vois pas en quoi un axe Paris-Berlin-Moscou pourrait nuire à nos intérêts. Les Américains y sont très hostiles… Enfin, les Américains, c’est un peu vite dit, il y a une différence entre Trump et le Congrès. Mais l’État profond américain est très hostile à la Russie, ce qui peut se comprendre parce qu’il n’a aucun commerce avec elle. Ce n’est pas notre cas.
Je pense d’ailleurs que l’Amérique se trompe de politique. Elle a renoncé au triangle stratégique de Kissinger, qui postulait que Washington devait toujours être plus proche de Moscou et de Pékin que Moscou et Pékin entre elles. Ce triangle stratégique kissingerien est bien illustré par l’année 1972 avec, en février, la visite de Nixon à Pékin et, en mai, sa venue à Moscou pour la signature du traité SALT. Aujourd’hui, l’Amérique est un catalyseur, par sa politique extrêmement antirusse, du rapprochement entre Moscou et la Pékin, au point que la Russie a invité les militaires chinois à participer aux manœuvres Vostok qui ont lieu du 11 au 15 septembre dans l’Est du pays.

C’est une erreur stratégique des américains. La Russie n’est plus en état d’être un concurrent stratégique. C’est la Chine qui l’est, et qui va supplanter les États-Unis. C’est la Chine qui a déjà conquis illégalement plus de mille hectares de terre sur les récifs des Paracels et des Spratleys, ces îlots où elle aménage des bases militaires, qu’elle veut même doter, paraît-il, de centrales nucléaires. Cet expansionnisme maritime chinois, les « Routes de la soie », le pillage systématique de la technologie occidentale, les déficits de commerce énormes entre la Chine et l’Amérique… tout cela est beaucoup plus grave que les Russes qui récupèrent Sébastopol, lequel est, quand même, un port russe.
LCDR : Emmanuel Macron a estimé récemment qu’il n’y avait pas de solution pour la sécurité en Europe sans la Russie. Donc, en creux, il appelle à l’organisation d’une conférence sur la sécurité en Europe. Est-ce que cela vous semble réalisable ?
R.G. : J’appelle depuis longtemps, dans mes chroniques pour le Figaro, à la constitution d’une nouvelle conférence pour la sécurité en Europe. Je ne peux donc que me réjouir, qu’Emmanuel Macron fasse sienne cette idée. Aura-t-il suffisamment de partenaires pour l’épauler, cela reste à voir. Une telle conférence ne peut se faire qu’avec la participation américaine.
Emmanuel Macron est parvenu à instaurer de bonnes relations avec Donald Trump, mais ce dernier n’a pas les coudées franches : il est sans arrêt obligé de prouver qu’il n’est pas prorusse. Le président américain a accepté de venir à Paris le 11 novembre prochain pour assister au défilé militaire du centième anniversaire de la victoire ; mais comme il n’est pas vraiment en mesure de faire une grande politique étrangère, on ne sait pas ce que ça va donner. Et si les Américains ne sont pas associés à cette conférence sur la sécurité en Europe, vous ne pouvez pas compter sur des pays comme, par exemple, la Pologne ou les États baltes, qui sont complètement et volontairement inféodés aux États-Unis, pour des raisons historiques très compréhensibles, qui remontent à la fin des années 1930, très précisément au pacte Molotov-Ribbentrop.

Il y a une autre difficulté pour Macron. C’est un homme, qui, par son énergie, sa culture, sa jeunesse, a suscité, et suscite toujours, beaucoup d’espoirs en Europe. L’Angleterre étant aux abonnés absents, Merkel vieillissante et politiquement affaiblie, il pourrait s’emparer d’un leadership désormais vacant sur le continent. Le problème est que vous ne pouvez pas être suivi par vos partenaires européens si vous n’êtes pas vous-même un exemple. Selon moi, c’est une chose que le président français n’a pas suffisamment intériorisée. Le général de Gaulle a pu construire sa grande politique étrangère parce que sur le plan intérieur, la France était irréprochable et faisait l’admiration de l’Europe entière, sinon du monde entier. Il n’y avait pas de désordre dans les finances publiques, le pays était en croissance, son industrie se développait, sa recherche fonctionnait, son éducation était d’un très haut niveau.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Emmanuel Macron n’a pas encore apporté la preuve, alors qu’il est au pouvoir depuis seize mois, d’une véritable volonté de réforme de l’État français. Tant que les comptes publics du pays n’auront pas été rétablis ‒ et on en est encore loin au vu du dernier budget, qui est un budget « hollandais » ‒ nous n’aurons pas le respect de l’Allemagne et des autres pays. Le couple franco-allemand ne fonctionnant pas à sa pleine puissance, on n’arrive finalement à rien. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Macron veut tout faire en même temps, eh bien non ! Il faut d’abord rétablir les comptes publics français. Pour développer cette grande politique étrangère, que le président français dessine fort intelligemment, il nous manque cette indispensable exemplarité intérieure.
« Il y a un attachement de la Russie à la France, à l’âme de la France, bien supérieur à l’importance géopolitique ou économique française dans le monde. »
LCDR : Est-ce que c’est aussi un pré-requis pour avoir la considération de la Russie ?
R.G. : Moins, parce que les Russes ont une vision plus romantique des relations internationales. Pour eux, c’est la France de Louis XIV, de Bonaparte, de Félix Faure… de Charles de Gaulle, de Normandie-Niemen, de la littérature française, des Trois Mousquetaires… qui compte avant tout. C’est une vision, un attachement culturel très fort de la Russie à notre pays, qui remonte au XIXe siècle. À l’époque, toutes les familles russes de la haute société parlaient français. Il y a un attachement de la Russie à l’âme de la France, bien supérieur à l’importance géopolitique ou économique française dans le monde. Je dirais même que dans l’esprit russe… pas dans celui de Vladimir Poutine, qui parle allemand, mais dans l’esprit russe, la France est un pays qui compte peut-être encore plus que l’Allemagne, alors qu’économiquement ce n’est pas le cas. Je pense donc que cet aspect est moins important pour les Russes, qui d’ailleurs n’offrent pas chez eux un modèle de gestion à faire pâlir d’envie les Français ! Rires.
Hungary’s Democracy Is in Danger, E.U. Parliament Decides
By Patrick Kingsley and Steven Erlanger
European lawmakers voted by a wide margin on Wednesday to begin a punishment procedure against Hungary for potentially breaching democratic norms, a measure never previously initiated by the European Parliament.
The vote was only the first step toward potential sanctions. The leaders of the European Union’s 28 member states must ultimately decide if the government of Prime Minister Viktor Orban is at fault, and whether it should be punished.
But it was nevertheless a meaningful moment in contemporary European politics, because it showed Mr. Orban — for years sheltered by Europe’s center-right leaders, even as he undermined the rule of law in Hungary, criticized European institutions, and became a hero of the far right — losing the support of most of his allies in the European mainstream.
The measure passed 448-197, narrowly meeting a two-thirds threshold needed to validate it, after a majority of Mr. Orban’s conservative alliance broke with him.
That alliance, the European People’s Party, whose members include the leaders of the European Parliament, European Commission and European Council, as well as Chancellor Angela Merkel of Germany, had avoided publicly criticizing Mr. Orban, despite rising external objections to his autocratic tendencies in Hungary and his shift toward more extreme positions on European identity, migration and integration.

That changed on Wednesday, when 115 members of the alliance voted against Mr. Orban’s government. Only 57 voted to support him, while 28 abstained. Manfred Weber, the alliance’s leader in the European Parliament, and Chancellor Sebastian Kurz of Austria, who leads another party in the alliance that has shifted right, both backed the measure.
The government of Hungary said the vote was not valid, because it did not reach the two-thirds threshold once abstentions were included.
Considered for much of his career a conventional center-right politician, Mr. Orban began to arouse criticism after returning to office in 2010 with an unexpectedly large majority that he used to stack the Hungarian constitutional court with loyalists, reshape the electoral system, and install loyalists at the top of major state institutions.
Five years later, he emerged as a hero to the far right after calling for the legalization of the death penalty — banned by European Union convention — and for an end to liberal democracy. His opposition to European migration policy and his call for a “cultural counterrevolution” in Europe put him in conflict with the European Union’s leadership.
But Mr. Orban’s own political alliance publicly stood by him, and might even have voted with him on Wednesday but for his increasingly provocative behavior since the start of the year.
This summer he has appeared more comfortable in the company of far-right figures such as Matteo Salvini, the new Italian interior minister, and Stephen K. Bannon, President Trump’s former chief strategist, than with his traditional allies in the center-right alliance.
The final straw came in a fractious private meeting of the alliance Tuesday night, when Mr. Orban refused to make any compromises, even claiming that he had no control over the actions of his lawmakers in Budapest, according to two people present at the meeting. The argument lasted for so long that the alliance’s interpreters left, leaving the members to debate in English rather than their mother tongues.
Image

The parliamentary vote came on the same day that Jean-Claude Juncker, the president of the European Commission, made what is expected to be his last “state of the union” speech before European Union elections next spring.
Mr. Juncker called for the bloc to be more aggressive in exercising its collective power, especially to defend a multilateral world order under threat from President Trump, Russia and China.
“The geopolitical situation makes this Europe’s hour: The time for European sovereignty has come,” Mr. Juncker said grandly.
“Whenever Europe speaks as one, we can impose our position on others,” he said, arguing that a deal he struck in July with Mr. Trump to try to negotiate a solution to a potential trade war showed the power of unity.
The union is largely united on trade issues, but has deep divisions on questions such as migration, security, values, and challenges to democratic and legal norms from central European members, especially Hungary and Poland.
Mr. Juncker, a federalist of the old school, also called for the euro currency to become more of a rival to the dollar for purchases of energy and high-tech European products like airplanes. The Europeans are struggling to preserve a nuclear deal with Iran in the face of American opposition, but are stymied by American secondary sanctions, given the dominant role that the dollar plays in international trade and banking.
He also called for more investment in European defense, and for controlling migration by shoring up the bloc’s external borders and investing in countries from where many of the migrants originate.

















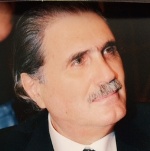








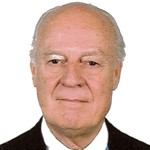




MADRID – Discussions about Europe-wide elections are invariably infused with expectations of dramatic change that rarely, if ever, are met. But the upcoming European Parliament election in May 2019 may break the mold, as it could determine the outcome of an ongoing struggle between two visions for Europe’s future: progress toward greater openness and interconnectedness or a reversion to divisive and blinkered nationalism.
Previous European Parliament elections have been preceded by promises that the vote would mean something to the electorate. But, whatever structural and institutional changes have occurred, from increasing the body’s powers to introducing new campaigning procedures, the results have remained lackluster.
With voters unconvinced that European Parliament elections have any concrete impact, domestic political calculations dominate, with citizens using their votes – when they bother to vote at all – to send signals to national parties and punish incumbents. In fact, even as the European Parliament has gained more authority, voter turnout in European elections has steadily decreased since 1979, reaching a low of 42.5% in 2014.
But this year, the election really does matter. An increasingly organized coalition of nationalist forces that are hostile to European integration – and, indeed, to European values – has been gaining traction and cohesion. These forces include Fidesz in Hungary, the Law and Justice (PiS) party in Poland, Germany’sAlternative für Deutschland, the Swedish Democrats, the League in Italy, Marine Le Pen’s National Rally (formerly the National Front) in France, and Geert Wilders’ Dutch Freedom Party.
Opposition to the EU is not new; nor are nationalist parties. But these parties have deepened their cooperation with one another since the last European elections in 2014, particularly on the issue of migration. In August, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán and Italian Interior Minister Matteo Salvini held a “summit” where they called for a united front against French President Emmanuel Macron’s pro-integration vision of Europe.
Beyond the clear irony of the far right’s internationalism, this unification of nationalist parties into a Europe-wide force is highly dangerous – not least because these forces have coalesced around a clear, forceful, and, for many, compelling message. To face the challenges of the future, they declare, Europe must return to a less uncertain time, when sovereign countries’ closed borders kept foreigners out.
The nostalgia on which these leaders successfully campaign cannot serve as a basis for policy, because the world they describe never existed. But those who recognize the far-reaching benefits of an open and forward-looking EU are struggling to make their case in a persuasive way. They, too, are focusing on the past, often citing a laundry list of accomplishments; but their version comes across as technical and bloodless. In order to convince a skeptical public that Europe’s strength lies in cooperation, European leaders need to focus on the future. They cannot simply rely on past successes. We have peace and prosperity and no more data roaming charges, but what’s next?
“More unity” is not an adequate answer, even if some treat it as one. In general, abstract and lofty visions are not good enough to compete with the simple and potent message espoused by nationalists.
This does not, however, mean that Europe’s defenders should attempt to hijack the nationalists’ vocabulary to serve a pro-European agenda, as European Commission President Jean-Claude Juncker did when he called for “European sovereignty” – whatever that is – in his recent state of the union address. Pro-European leaders cannot forge a new way forward by making themselves look more like nationalists; on the contrary, they must show just how different they are.
This means combining ideals with tangible proposals for Europe’s development. It means showing why the EU is the most viable and appealing vehicle to take Europe into an ever-more prosperous future. It means proving that the EU is better equipped than individual states to address contemporary challenges, particularly in a world in which a critical mass of power (military, economic, demographic) is increasingly necessary to have any room for maneuver. And it means convincing citizens that the EU, as a community of nations, offers the best chance to strengthen economic resilience, foster innovation, and preserve Europe’s cultures.
Macron has become the poster child for this approach. Too often, however, his is a lone voice; his fellow defenders of Europe nod quietly in agreement, but are unwilling to take political risks of their own. In the months leading up to the May election, all who believe in a European approach to European problems must step up.
The campaign is just beginning, so there is still time to change the narrative and put Europe on a path toward greater influence and increased prosperity. But the window of opportunity is closing fast. Unless those who understand the value of the EU wake up soon and respond effectively to their increasingly unified nationalist adversaries, it will be too late.
Europe faces a stark choice: Will its nation-states move forward together, building strength upon strength, or will they take separate paths, each leading to mediocrity? Believe it or not, the outcome of the upcoming election really does matter. For Europe, the stakes could not be higher.